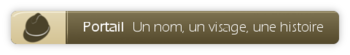Jules Dufrien (1895-1918)
Jules Dufrien est né le 26 août 1895 à Hamblain-les-Prés.
Soldat de 2e classe au 4e régiment de chasseurs d’Afrique. Mort pour la France le 11 octobre 1918 (Salonique), des suites de maladie. Ses funérailles ont été célébrées à Hamblain-les-Prés le 5 mars 1922, en même temps que celle de Paul Caridroit (1868-1917). Au cours de ses funérailles, le directeur du journal La Campagne d'Artois prononça un discours exalté[1] :
« Je n'ai jamais connu d'âme de jeune homme plus blanche, plus naturellement droite, plus simplement noble que celle qui animait la dépouille de Jules Dufrien à qui nous rendons aujourd'hui les derniers devoirs.
Avant la guerre, il frappait par la saine fraicheur de son teint, la bonté de son sourire, la candeur de ses yeux bleus. En cet enfant du sol français, on sentait in digne frère de Jeanne d'Arc. Il n'était pas meilleur fils : sa mère est le premier chagrin - mais quel chagrin ! - qu'il est causé à ses parents.
Il n'était pas de chrétien plus humblement soumis aux enseignements et aux prescriptions de sa Foi.
Il n'était pas de Français aimant son pays d'un amour plus ardent, plus profond, plus entier. Élevé à un foyer où les traditions d'un heureux passé national étaient jalousement gardées à l'abri des souffles changeants de l'heure, il était royaliste parce qu'il était Français intégralement. À qui lui disait : « Il faut marcher avec son siècle », il répondait comme Bonald : « Il faut marcher avec tous les siècles ».
La veille de son départ pour le front d'Artois, le 21 juin 1915, il m'écrivait d'Angers : « Je donne mon âme à Dieu, mon cœur au Roi, mon sang à la France ». Tel fut le triple amour qui, avec celui de ses parents bien aimés, soutint son âme, garda intact son admirable moral pendant trois ans et trois mois de la plus dure des guerres. Si quelques mots doivent être gravés sur sa tombe, je demande que ce soient ceux-là que nous retrouvons encore dans sa dernière lettre : « (...) À la veille d'entrer en action, et après avoir vu le courage que vous avez eu pendant trois ans, je vous demanderai de contibuer à l'avoir si Dieu venait à appeler votre fils auprès de lui ; car ne craignez rien mes bons parents, je reste digne de votre sang ; je resterai digne de ce que vous m'avez appris et fait apprendre ; je marcherai la tête haute en offrant mon âme à Dieu, mon cœur au Roi et mon sang à la France ; pour vous mes bons parents, je vous laisse le souvenir d'un fils digne de votre nom ; ma dernière pensée sera pour vous, car je sais la peine que vous fera cette perte ; mais soyez courageux, mes bien aimés parents, car quand vous recevrez cette lettre, votre fils aura payé de sa vie sa noble dette de Français. Restez digne de votre fils comme votre fils restera digne de vous ; si le malheur vous frappe, ne perdez pas votre temps dans le découragement ; soyez fort, priez pour demander au bon Dieu le courage et la force de supporter cette épreuve ; priez aussi pour le repos de l'âme de votre fils ; priez, priez, c'est là la seule force, le seul courage et le seul soulagement, car vous savez mieux que moi que le cœur de Dieu ne s'attendrit pas par le murmure ni par les larmes, mais par le courage et la prière.»
C'est le 11 octobre dernier qu'elle devait partir cette lettre que je ne sais pas de termes pour qualifier dignement. Il était venu me voir à Paris au cours de la guerre : l'air du front en avait fait un hercule taillé, semblait-il, pour tenir jusqu'au bout et revenir un jour reconstruire vaillamment la foyer familial. Mais chez lui, l'âme était encore plus exigeante que le corps n'était robuste ; il lui semblait n'avoir rien fait tant qu'il restait à faire. Ce jeune chêne n'est pas tombé sous les projectiles : il a été écrasé sous l'accumulation des devoirs héroïquement acceptés.
On demande parfois qui a gagné la guerre... La supériorité de notre artillerie ? Sans doute. Le secours de nos alliés ? Cela va sans dire. Le génie de nos généraux ? Certainement. Le courage et l'endurance de nos soldats ? Incontestablement. L'unité de commandement ? L'histoire le dira.
Mais avant tout cela, il s'en est fallu, hélas ! de bien peu, à de certaines heures, que ce fut la défaite. C'est notre évêque, Monseigneur Julien, qui un dimanche de septembre a prononcé du haut de la chaire de Bossuet la formule définitive quand il a appelé la victoire de la Marne : « Un chef-d’œuvre militaire du génie français auquel Dieu a souri ». Il y a fallu le sourire de Dieu, mais pourquoi Dieu a-t-il souri à la France?
C'est parce qu'il a vu des foyers d'honneur et de devoir où s'élèvent des âmes droites, simples et pures comme celle de Jules Dufrien et qu'Il en veut voir encore. Le génie des capitaines et des ingénieurs pèsent moins dans les balances éternelles que la vertu des humbles.
Jules Dufrien, c'est à toi, c'est aux petits bons et justes comme toi, comme la camarade qui dort là, à côté de toi, c'est à tes parents, c'est aux leurs que nous devons de mourir en terre française libre.
Aussi bien, c'est l'offensive de Bulgarie au terme de laquelle il est tombé épuisé, qui a déclenché la victoire en mettant hors de combat les alliés de l'Allemagne. Un mois après sa mort, jour pour jour, elle capitulait.
Qui peut dire si ce n'est pas le sang offert et accepté de ce juste, de cet agneau pascal, l'oblation de cette blanche hostie qui a marqué la fin du courroux céleste ? Moi qui ai pénétré la lumineuse beauté de cette âme, j'ai le droit de la croire et de la dire. Je le crois et je le dis.
Jules Dufrien, au revoir, à Dieu ! »
Lien interne
- Inscrit sur le monument aux morts d'Hamblain-les-Prés
Sources
Notes
- ↑ Journal La Campagne d'Artois, 12 mars 1922.